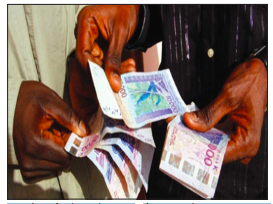FERMETURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES MALI–MAURITANIE : LA VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES MAURITANIEN N’AURA DONC PAS SUFFI À CALMER LE JEU ?

C’est par un cri de cœur des éleveurs mauritaniens que l’opinion aura su que Bamako a décidé récemment ses frontières terrestres avec la Mauritanie.
Une décision qui plonge les éleveurs nomades dans l’incertitude, des milliers de familles vivant de la transhumance se retrouvant isolées, privées d’accès aux pâturages et aux points d’eau essentiels à la survie de leur cheptel. Cette fermeture de frontière, qui ne peut être dissociée du climat de méfiance qui persiste depuis plusieurs années entre Bamako et Nouakchott, prouve que la récente visite d’un émissaire du président mauritanien, en la personne du ministre des Affaire Mohamed Salem Ould Merzoug, n’a pas suffi à calmer les ardeurs ! Cette situation, qui était pourtant évitable, si les deux Etats avaient eu le réflexe de mettre en avant les intérêts des deux peuples, inquiète profondément les autorités locales et menace la stabilité économique de l’Est mauritanien. Des régions entières sont désormais confrontées à une crise sociale latente, alors que le secteur de l’élevage demeure l’un des piliers de l’économie mauritanienne.
Les autorités maliennes ont, à plusieurs reprises, accusé la Mauritanie de laisser circuler sur son territoire des groupes armés soupçonnés de collusion avec des organisations terroristes opérant dans le centre et le nord du Mali.
En 2022, des tensions avaient déjà éclaté après l’assassinat de civils mauritaniens près de la frontière, incident que le gouvernement malien avait imputé à des éléments incontrôlés avant de promettre une enquête. Ces accusations récurrentes ont altéré la confiance entre les deux États, pourtant liés par des accords de coopération frontalière et sécuritaire signés depuis plus de vingt ans. Plus récemment, Bamako a reproché à Nouakchott de fournir, directement ou indirectement, une assistance logistique à certains groupes hostiles aux forces maliennes. Des sources maliennes affirment aussi que des hôpitaux mauritaniens auraient soigné des combattants blessés appartenant à des groupes armés opérant dans la zone sahélienne. Pour le gouvernement malien, la fermeture de la frontière constitue ainsi un moyen de faire pression sur la Mauritanie afin qu’elle cesse tout soutien présumé aux terroristes. Cette mesure reflète la volonté des autorités maliennes de renforcer leur contrôle territorial et de limiter les interactions perçues comme menaçantes pour leur sécurité nationale.
Si le gouvernement malien présente cette fermeture comme une nécessité sécuritaire, ses effets sont avant tout économiques et sociaux.
En effet, près de 70% des 30 millions de têtes qui constituent le cheptel mauritanien s’alimentent dans les pâturages du Mali. L’arrêt de la transhumance peut donc avoir des impacts socioéconomiques dans un pays où le secteur de l’élevage est l’un des principaux piliers de l’économie et représente environ 10,1% du PIB en 2020, 70% de la valeur ajoutée du secteur rural et emploie 10% de la population active. Sa fragilisation menace donc des milliers de foyers et pourrait accélérer l’exode vers les grandes villes mauritaniennes, déjà confrontées à un chômage croissant. À cela s’ajoute la dépendance de la Mauritanie vis-à-vis des exportations de bétail et des produits dérivés, essentiels pour la balance commerciale du pays. Côté malien, tout n’est pas rose non plus. En effet, cette décision frappe de plein fouet les maliens vivant de part et d’autre de la frontière, et qui ont pu établir des liens fraternels avec les mauritaniens. Elle constitue aussi un facteur de blocage à un moment où des défis sociaux graves assaillent le Mali, dont les autorités devraient plutôt, par bon sens, travailler à plus d’ouverture avec nos voisins. Le Président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani avait pourtant vu la menace venir, lui qui a dépêché, le 8 octobre dernier, un émissaire, en la personne de Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, auprès du Président de la Transition du Mali, le Général Assimi Goïta. Un geste fort qui visait sans doute à désamorcer la tension entre les deux pays qui commençait à prendre des proportions inquiétantes.
Ce premier pas important du voisin mauritanien devrait inspirer les autorités maliennes dans la préservation des relations de bon voisinage, nos pays et nos peuples étant condamnés à vivre ensemble.
Le ministre Ould Merzoug, lors de sa visite, n’a pas perdu de vue cette nécessité, c’est pourquoi il avait souligné l’importance de la concertation et du partenariat entre les deux nations, unies par des liens historiques et géographiques. Au cœur des discussions avec le Président Assimi Goïta, la situation des communautés et la coopération, avec une attention particulière portée à la situation des commerçants mauritaniens au Mali et celle des Maliens en Mauritanie. La fermeture des frontières avec la Mauritanie surprend donc, car le Général Assimi Goïta avait souligné la nécessité d’instauration d’un cadre de dialogue permanent afin de résoudre les problèmes de part et d’autre. Les relations entre le Mali et la Mauritanie ont toujours été secouées par des crises, mais pas de nature, en tout cas jusqu’à tout récemment, à inquiéter les ressortissants des deux pays, avec des actes belliqueux entravant l’esprit et la lettre de la Convention d’établissement et de circulation signée le 25 juillet 1963 entre les deux Etats. Ce texte fondateur garantit pourtant aux ressortissants des deux pays : la liberté de circulation et d’établissement sur le territoire de l’autre partie, l’exercice de toutes activités économiques licites, ainsi que le droit de propriété et de protection juridique équivalente à celle des nationaux.
Mais ces derniers temps, entre expulsions, fermetures et interdictions, et maintenant la fermeture des frontières, Bamako et Nouakchott brisent donc cet acquis historique et piétinent la libre circulation consacrée depuis 1963. La politique des représailles, menée de part et d’autre, transforme ainsi les peuples malien et mauritanien en victimes collatérales d’une diplomatie aveugle. ■
MAÏMOUNA DOUMBIA